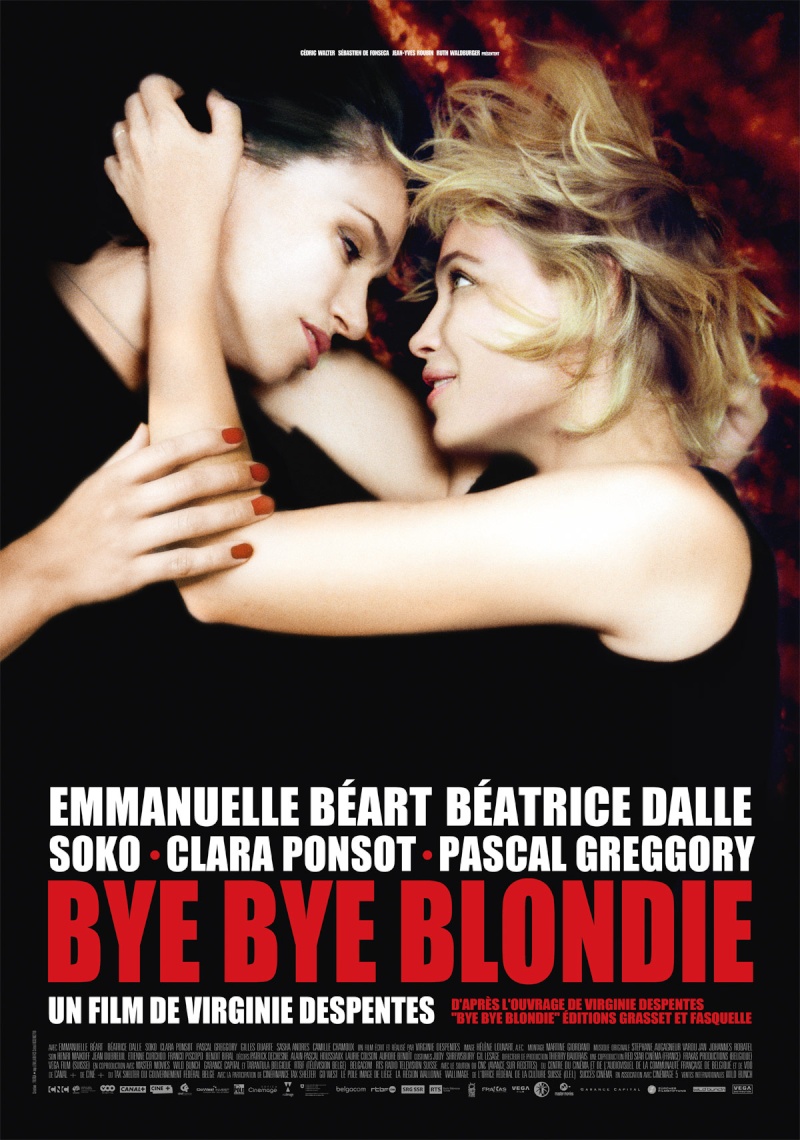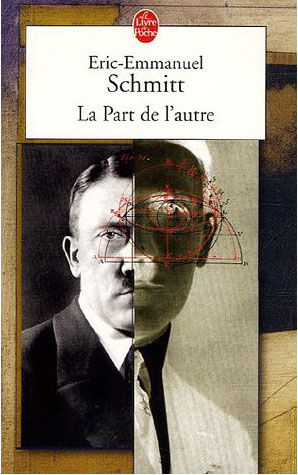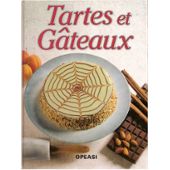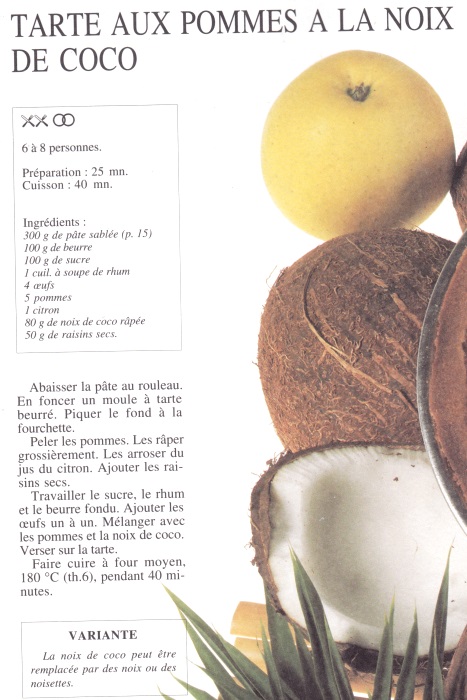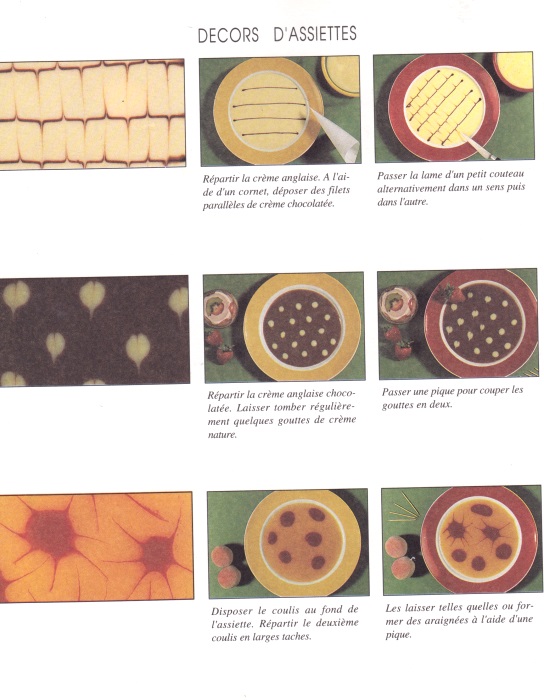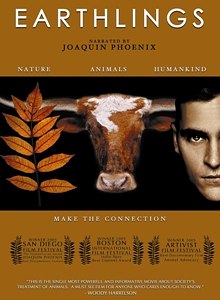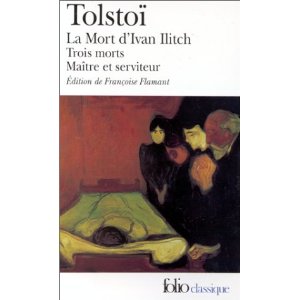Bret Easton Ellis est devenu grand mais il ne suffit pas de laisser filer le temps ; il faut aussi savoir dresser le bilan d’un certain passé. Ainsi, le récit de Lunar Park
commence à la manière d’un mea culpa. Bret Easton Ellis s’est assagi au tournant de la quarantaine et, chargé de cette décennie supplémentaire, il évoque les années d’American
Psycho (décennie de la vingtaine) et de Glamorama (décennie de la trentaine) comme de lointaines périodes qui semblent désormais loin de lui. Mais les cris d’orfraie les
plus virulents ne sont-ils pas poussés par ceux qui savent être le plus en droit de s’inquiéter ?
Le succès, la gloire, les relations artificielles, la drogue, les filles faciles, les grands lofts et les voitures hors de prix ont fait leur temps. Après s’être laissé charmer par les avantages
de la gloire violente, Bret Easton Ellis a connu une période de dépression profonde et d’hallucinations provoquées par le manque de ces drogues dont il a essayé de se passer –pas particulièrement
pour se sauver lui-même, mais bien plutôt pour rattraper les lambeaux d’une gloire finalement aussi éphémère qu’elle lui avait d’abord semblé éternelle. Au moment où il écrit Lunar
Park, Bret Easton Ellis vit une autre forme de rêve américain : marié, père de deux jeunes enfants de treize et sept ans, propriétaire d’une demeure avec piscine, passant son temps entre
cours à l’université, dîners avec les amis de la famille –d’autres couples avec enfants- et activités de développement personnel.
Pour autant, tout ne va pas pour le mieux. Au début, pourtant, Bret Easton Ellis tente de nous en persuader, mais l’aspect idyllique de sa nouvelle existence est bientôt perturbé par deux
phénomènes : dans la région où il habite, la disparition d’enfants des beaux quartiers fait régner la psychose tandis que dans sa nouvelle demeure, des manifestations inexplicables transforment
son habitation en maison hantée. Peut-on se racheter une bonne conduite avec une épouse, des enfants et une baraque ? Est-il si aisé de se détourner d’un passé marqué par deux décennies d’errance
et d’illusions ?
Une fois encore, après American Psycho, Bret Easton Ellis mêle la réalité et la fiction dans des mesures dont il sera difficile d’appréhender la juste valeur. Cette vie de
famille classique –bien qu’aisée- semble parfaitement crédible alors qu’en réalité, Bret Easton Ellis n’a jamais été marié. En revanche, plus fictives semblent être ces manifestations de
revenants qui se produisent dans sa maison –est-ce Patrick Bateman, le héros sanguinaire d’American Psycho, ou est-ce son père avec qui il a rompu tout contact ? Et le criminel
qui rôde autour des gosses de riches pour les capturer ne fait parler de lui que de loin, mystérieuse arlésienne dont les actes entraînent pourtant des conséquences dramatiques. Mais le roman
passe, et la tendance s’inverse. La famille modèle montre ses failles et devient aussi volatile qu’un rêve, tandis que les disparitions et les revenants prennent de l’ampleur et finissent par
envahir la vie et l’esprit de Bret Easton Ellis.
Celui-ci avait pensé pouvoir faire une croix sur son passé, rapidement et sans séquelles -il remarquera bientôt, avec une culpabilité mégalomaniaque, que l’artificialité et l’individualisme de
son mode de vie passé ont atteint toute une génération –celle qui succède à la sienne. Les enfants de Lunar Park sont de petits êtres effrayants qui déambulent, tels des zombies
dopés au Ritalin. Ils vagabondent d’une activité à une autre –reiki, yoga, cinéma, centre commercial, pilates, psychologue…- et acceptent de se plier aux exigences les plus loufoques de leurs
parents, au prix d’un désenchantement et d’une lucidité qui ressurgissent dans des dialogues surréalistes. Par ailleurs, le spectre de Patrick Bateman se fait de plus en plus oppressant et
envahit un Bret Easton Ellis qui semble de nouveau perdre pied dans la réalité –savant fou créateur d’un monstre dont l’horreur et le goût sanguinaire le dépassent désormais. Bret Easton Ellis se
sent responsable de l’avidité malsaine qu’il ressent autour de lui, et Lunar Park ressemble à une tentative d’expiation de sa culpabilité.
Bret Easton Ellis aurait-il envie de cesser de rire aux dépens de ses semblables, maintenant qu’il réalise que ses mauvaises blagues ne l’excluent pas non plus de leurs retombées funestes ? Après
Lunar Park, on se demande si Bret Easton Ellis va pouvoir continuer à écrire comme avant. Si oui, alors ce roman n’aura été qu’une vaste blague. Reste à savoir si cela nous
décevrait…
Pour les partisans de l'hypothèse : Breat Easton Ellis = fantastique du 21e s. -des ambiances mêlant banal et lugubre :
| Citation: |
| « Il y avait un corbeau caché dans les arbres derrière moi et je pouvais entendre les battements d’ailes et lorsque je l’ai vu tourner au-dessus de moi inlassablement je l’ai regardé fixement puisqu’il n’y avait rien d’autre à observer dans ce ciel blanc et qu’il y avait des choses auxquelles je ne voulais pas penser (et sur cette terrasse ce soir un autre écureuil sera éventré par une peluche que tu as achetée pour une petite fille) mais c’était ce qui se passait quand vous refusiez de visiter ou d’affronter le passé : le passé commence à vous rendre visite et à vous affronter. » |
Un passage qui m'interpelle :
| Citation: |
| Qu’était-il arrivé au simple désir de voir ses enfants contents et cool ? Qu’était-il arrivé à la possibilité de leur dire que le monde déconne ? Qu’était-il arrivé à la distribution de claques de temps en temps ? Ces parents étaient des scientifiques et ils n’élevaient plus leurs enfants instinctivement –chacun avait lu un livre ou vu une vidéo ou surfé sur le Net pour se faire une idée de ce qu’il fallait faire. […] il y avait des enfants de cinq ans qui avaient des gardes du corps (la fille d’Adam Gardner). Il y avait des enfants au bord de l’évanouissement à cause de la pression subie en cours élémentaire et qui suivaient des thérapies parallèles, et il y avait des enfants de dix ans qui souffraient de désordres alimentaires provoqués par des représentations irréalistes de leur corps. Il y avait des listes d’attente remplies des noms d’enfants de neuf ans pour les séances d’acupuncture du Dr Wolper. […] Et puis on a parlé de : supprimer les pâtes dans le menu des déjeuners à la cantine, du nutritionniste qui avait fait office de traiteur pour la bar-mitsva, et des cours de Pilates pour des enfants de deux ans, la petite fille de huit ans qui a besoin d’un soutien-gorge de sport, le petit garçon qui tire sur la jupe de sa mère dans le supermarché de luxe pour lui demander : « Il y a des hydrates de carbone dedans ? » |
Et une pointe d'humour désespéré:
| Citation: |
|
« Voilà les enfants, ai-je annoncé à Jay en désignant Robby et Sarah. Son look à elle, c’est glam et le rose est très tendance pour les six-sept ans cette saison. Robby, lui, s’habille
hip-hop, en blanc et il est désormais officiellement un tween. - Un tween ? a beuglé Jay, puis murmuré en se penchant vers moi, Attends, ce n’est pas un truc gay, non ? – Non, c’est un tween. Tu comprends, c’est quelqu’un qui n’est plus un enfant et qui n’est pas encore un teenager. - Mon Dieu, a soufflé Jay. Ils ont pensé à tout, hein ? » |