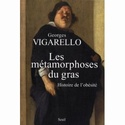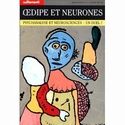A une époque où la frénésie des voyages et des grandes expéditions commençait seulement à prendre son essor, certains, pressentant déjà la monotonie qui gagnerait le cœur des vagabonds quelques décennies plus tard, se prenaient déjà à imaginer des vagabondages plus fantastiques. Puisqu’on aura bientôt fait le tour de la Terre, pourquoi ne pas prévenir la lassitude qui ne saurait tarder d’apparaître en se plongeant directement dans ses entrailles ?
Nous sommes d’accord –et Jules Verne aussi- une telle idée ne pouvait naître que dans l’esprit un peu hétérodoxe d’un savant fou. Le professeur Lidenbrock, grand fantasque, maigre et sec comme une trique, nerveux comme une ampoule électrique mais déconnecté de la réalité, convient parfaitement au rôle. Qu’on ne cherche pas la nuance : Jules Verne n’ambitionne pas de détailler ses personnages dans les moindres ambiguïtés de leur caractère. Il en fait des types plutôt grossiers dont la description nous les rendra immédiatement familiers. Non pas qu’on ne les connaisse de longue date, mais on les a déjà rencontrés ailleurs, sous d’autres noms peut-être, mais leur essence reste la même.
« Il était professeur au Johannaeum, et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère une fois ou deux. Non point qu’il se préoccupât d’avoir des élèves assidus à ses leçons, ni du degré d’attention qu’ils lui accordaient, ni du succès qu’ils pouvaient obtenir par la suite ; ces détails ne l’inquiétaient guère. Il professait « subjectivement », suivant une expression de la philosophie allemande, pour lui et non pour les autres. C’était un savant égoïste, un puits de science dont la poulie grinçait quand on en voulait tirer quelque chose : en un mot, un avare. »
Le professeur Lidenbrock, fort de la maîtrise d’une modeste douzaine de langues, intercepte un message crypté glissé entre deux feuillets d’un volumineux manuscrit. La compréhension du code posera problème cinq minutes, et puis le message finira par être déchiffré, comme l’on s’y attend. Quel suspens… impossible d’imaginer quelle sera la teneur du message… Quoi ? Vraiment ? Un homme aurait trouvé une voie pour s’infiltrer jusqu’au centre de la Terre ? Ainsi, tout le mystère du titre du roman s’éclaire ! Et Lidenbrock, émoustillé par une idée aussi saugrenue qui irait à l’encontre des principales théories de son époque –si on peut se rendre au centre de la Terre, alors la température n’y est pas aussi élevée que ce que disent les plus grands scientifiques- décide de suivre les traces de ce précurseur et de s’engager à son tour jusqu’aux entrailles de la Terre. Tout ceci est rapporté par son neveu, jeune dadais romantique et naïf, possédant juste ce qu’il faut de science pour affronter son oncle lors de passionnantes discussions théoriques. Celui-ci, à force de ne vouloir rien faire, finira par être embarqué dans le sillage de son oncle pour un Voyage au centre de la Terre.
Récit d’aventure bien rythmé, pas avare en péripéties et en étapes géographiques, ce roman entraînera ses personnages à crapahuter d’abord en Islande, aussi loin du monde civilisé que possible, avant de leur faire découvrir les profondeurs de la planète. Au cours de leur expédition, ils embarqueront avec eux un guide islandais. Pas pénible du tout, celui-ci a l’avantage de ne s’exprimer que par monosyllabes (ce que l’on traduirait par « oui » ou « non » en islandais) et de gérer d’une main de maître les bagages et provisions des deux énergumènes qu’il accompagne. Jules Verne n’aime pas s’embarrasser de complications, qu’il s’agisse de personnages, de situations ou d’énigmes. Ces dernières, par exemple, justifient leur existence dès lors qu’elles sont citées. La question importe plus que la réponse. Le plaisir loge dans l’interrogation et la spéculation intellectuelle qui en découle, plus que dans la certitude du fait accompli.
En lui-même, le Voyage au centre de la Terre n’a rien qui ne parvienne à égaler les artifices en trois dimensions que serait capable de nous fournir le cinéma aujourd’hui. On le verra, la progression de l’aventure sera plutôt linéaire. Le dépaysement, si tant est qu’il existe, s’inspire des données des sciences archéologique, biologique et géologique, dernières en date apparues pour tenter d’expliquer l’évolution d’un monde, de sa flore et de sa faune. Sous les profondeurs de la Terre, rien de neuf ne surgit de l’esprit de Jules Verne, mais la découverte d’un monde différent que celui qui bruisse à la surface ; une possibilité parmi tant d’autres. Jules Verne, précurseur de la théorie des univers parallèles, un siècle avant que Hugh Everett ne l’énonce ? Mieux encore ! Puisque sous terre, il est possible de constater la présence d’un ciel, quid de celui qui surplombe nos épaules sur ce que l’on croit être la « surface » de la Terre ? Cette fois, Jules Verne anticipe les spéculations des théoriciens de la « Terre creuse », dont Louis Pauwels nous avait parlé dans son livre Le Matin des magiciens :
« Pour les partisans de la terre creuse qui organisèrent la fameuse expédition parascientifique de l’Ile de Rügen, nous habitons l’intérieur d’une boule prise dans une masse de roc qui s’étend à l’infini. Nous vivons plaqués sur la face concave. Le ciel est au centre de cette boule : c’est une masse de gaz bleutée, avec des points de lumière brillante que nous prenons pour des étoiles. Il n’y a que le soleil et la lune, mais infiniment moins grands que ne le disent les astronomes orthodoxes. L’univers se limite à cela. Nous sommes seuls, et enveloppés de roc. »
Mais Jules Verne ne s’étend pas sur les interrogations que suscite le monde qu’il met en place. Véritable jouisseur des mots et des images, il s’amuse à faire voyager ses personnages de tableaux en tableaux, faisant naître une flore et une faune dont les monstruosités côtoient les ondoiements des roches et des minéraux :
« Aux schistes succédèrent les gneiss, d’une structure stratiforme, remarquables par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets, puis les micaschistes disposés en grandes lamelles rehaussées à l’œil par les scintillations du mica blanc.
La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ses jets de feu sous tous les angles, et je m’imaginais voyager à travers un dimant creux, dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements.
Vers six heures, cette fête de la lumière vint à diminuer sensiblement, presque à cesser ; les parois prirent une teinte cristallisée, mais sombre ; le mica se mélangea plus intimement au feldspath et au quartz, pour former la roche par excellence, la pierre dure entre toutes, celle qui supporte, sans en être écrasée, les quatre étages de terrains du globe. Nous étions murés dans l’immense prison de granit. »

Jules Verne excelle dans la représentation de cette beauté naturelle, subtilement remaniée par ses soins. Si l’on ne sait pas vraiment ce que le professeur Lidenbrock et son neveu recherchent en s’engageant jusqu’au centre de la Terre, en revanche, on sait quelles sont les motivations de Jules Verne : donner la possibilité à son émerveillement biologique et géologique de s’épanouir au sein d’une trame dramatique. Pour parler de sa prose en elle-même, peut-être devra-t-on en revanche oser avancer l’hypothèse qu’elle s’inspire plus vraisemblablement de celles qui parcourent ses ouvrages de vulgarisation scientifique que de celles qui définissent ce que l’on appelle couramment la « grande littérature ». Lorsqu’il ne sait pas comment conclure les situations qu’il a amorcées, Jules Verne s’en sort souvent par une résolution en queue-de-poisson : ainsi décide-t-il subitement, au milieu du livre, d’amorcer l’écriture d’un journal de bord tenu par le neveu ; puis, voyant que le procédé ne tient pas la route, il décide de l’interrompre subitement pour revenir à la narration habituelle et se justifie maladroitement par une note entre crochets :
« [Ici mes notes de voyage devinrent très incomplètes. Je n’ai plus retrouvé que quelques observations fugitives, prises machinalement pour ainsi dire. Mais dans leur brièveté, dans leur obscurité même, elles sont empreintes de l’émotion qui me dominait, et mieux que ma mémoire, elles donnent le sentiment de la situation.] »
Jules Verne n’hésite pas non plus à avouer que les mots lui manquent lorsqu’il s’agit de décrire les sensations éprouvées par ses personnages. Les confessions se multiplient au fil de la progression du voyage :
« Toutes ces merveilles, je les contemplais en silence. Les paroles me manquaient pour rendre mes sensations. Je croyais assister, dans quelque planète lointaine, Uranus ou Neptune, à des phénomènes dont ma nature « terrestrielle » n’avait pas conscience. A des sensations nouvelles, il fallait des mots nouveaux, et mon imagination ne me les fournissait pas. »
Heureusement, les images sont là pour pallier aux limites naturelles du langage. Chaque chapitre est accompagné d’une vignette en noir et blanc effectuée par Riou. Racées et précises, elles apportent du charme à cette histoire un brin désuète –en cela même, attachante- et rappellent d’autres contes fantastiques de la même époque –que l’on pense par exemple à Alice au pays des merveilles. D’ailleurs, le Voyage au centre de la Terre aurait également pu s’intituler Voyage au pays des merveilles ; hormis le fait que le déplacement est ici aussi primordial que la destination.
« - Et le retour ?
- Le retour ! Ah ! tu penses à revenir quand on n’est pas même arrivé !
- Non, je veux seulement demander comment il s’effectuera.
- De la manière la plus simple du monde. Une fois arrivés au centre du sphéroïde, ou nous trouverons une route nouvelle pour remonter à sa surface, ou nous reviendrons tout bourgeoisement par le chemin déjà parcouru. J’aime à penser qu’il ne se fermera pas derrière nous. »

O folie joyeuse ! Et c’est dans cet état d’esprit insouciant/inconscient que Jules Verne nous mène à la baguette. La science n’est pas terne, et loin d’être triste : grâce à elle, les hommes deviendront les égaux de Lidenbrock, sautillant allègrement entre des parois de feldspath et de quartz, virevoltant entre les troncs démesurés des « lyoperdon giganteum », et s’abreuvant aux sources joyeuses de la biologie et de la géologie !
| Citation: |
|
[…] M. Fridriksson m’apprit que ce tranquille personnage n’était qu’un « chasseur d’eider », oiseau dont le duvet constitue la plus grande richesse de l’île. En effet, ce duvet s’appelle
l’édredon, et il ne faut pas une grande dépense de mouvement pour le recueillir. Aux premiers jours de l’été, la femelle de l’eider, sorte de joli canard, va bâtir son nid parmi les rochers des fjords dont la côte est toute frangée. Ce nid bâti, elle le tapisse avec de fines plumes qu’elle s’arrache du ventre. Aussitôt le chasseur, ou mieux le négociant, arrive, prend le nid, et la femelle de recommencer son travail. Cela dure ainsi tant qu’il lui reste quelque duvet. Quand elle s’est entièrement dépouillée, c’est au mâle de se plumer à son tour. Seulement, comme la dépouille dure et grossière de ce dernier n’a aucune valeur commerciale, le chasseur ne prend pas la peine de lui voler le lit de sa couvée ; le nid s’achève donc ; la femelle pond ses œufs ; les petits éclosent, et, l’année suivante, la récolte de l’édredon recommence. |
Profitons des réflexions du professeur Lidenbrock...
| Citation: |
| - Voici ce que je décide, répliqua le professeur Lidenbrock en prenant ses grands airs : c’est que ni toi ni personne ne sait d’une façon certaine ce qui se passe à l’intérieur du globe, attendu qu’on connaît à peine la douze-millième partie de son rayon ; c’est que la science st éminemment perfectible, et que chaque théorie est incessamment détruite par une théorie nouvelle. N’a-t-on pas cru jusqu’à Fourier que la température des espaces planétaires allait toujours diminuant, et ne sait-on pas aujourd’hui que les plus grands froids des régions éthérées ne dépassent pas quarante ou cinquante degrés au-dessous de zéro ? Pourquoi n’en serait-il pas ainsi de la chaleur interne ? Pourquoi, à une certaine profondeur, n’atteindrait-elle pas une limite infranchissable, au lieu de s’élever jusqu’au degré de fusion des minéraux les plus réfractaires ? |
Et lorsqu'il discute avec son neveu...
| Citation: |
|
- Je ne comprends pas la présence de pareils quadrupèdes dans cette caverne de granit. - Pourquoi ? - Parce que la vie animale n’a existé sur la terre qu’aux périodes secondaires, lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions, et a remplacé les roches incandescentes de l’époque primitive. - Eh bien ! Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection, c’est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire. - Comment ! à une pareille profondeur au-dessous de la surface de la terre ! - Sans doute, et ce fait peut s’expliquer géologiquement. A une certaine époque, la terre n’était formée que d’une écorce élastique, soumise à des mouvements alternatifs de haut et de bas, en vertu des lois de l’attraction. Il est probable que des affaissements du sol se sont produits, et qu’une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres subitement ouverts. - Cela doit être. Mais, si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l’un de ces monstres n’erre pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrières ces rocs escarpés ? |