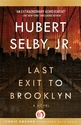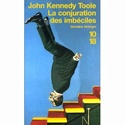La psychiatrie à peine née, voici qu’apparaît son versant opposé : l’anti-psychiatrie. Ne nous méprenons pas sur l’objet des griefs portés par ses chefs de file, David Cooper et Ronald Laing en tête : l’anti-psychiatrie ne vise pas à l’abolition de la psychiatrie mais se considère comme un de ses courants. Elle conteste la psychiatrie « classique » considérée comme une force d’oppression institutionnelle élaborée par et pour des gens « normaux » (Donald Cooper nous montrera au passage que la normalité, si elle se situe à l’opposé de la folie, se situe aussi à l’opposé de la santé).
Dans son essai court mais convaincant, David Cooper commence en revenant sur les fondements de la discipline : sa terminologie. Suffit-il de désigner une chose par un terme pour que le sujet soit clos ? Les patients principalement ciblés par la psychiatrie, ceux qu’on nomme « schizophrènes », souffrent-ils tous, réellement, d’un seul et même trouble ? Le doute apparaît dès l’instant où l’on essaie de donner une définition de cette pathologie, que David Cooper juge avoir été inventée de toutes pièces par les membres de l’institution psychiatrique classique… A la base de la schizophrénie, une palette de causes qui semble infinie… A sa suite, des réactions qui, bien que stéréotypées, s’expriment à travers des propos et des idées qui traduisent l’empreinte d’une personnalité propre. Rien à voir, donc, avec une pathologie classique telle qu’un rhume ou qu’une angine.
David Cooper dénonce le subterfuge de l’invention de la schizophrénie en redéfinissant cette dernière non plus en termes de pathologie mais en termes sociaux et culturels. La schizophrénie serait la réaction de survie exprimée par un individu ayant grandi dans un univers aliénant et incohérent, à la base d’une violence d’autant plus sournoise et diffuse qu’elle ne se verbalise pas, qu’elle provient des membres de la famille proche –qui eux-mêmes n’en sont pas conscients, qui eux-mêmes sont également victimes d’une situation qui leur échappe- et qu’elle existe depuis toujours dans le cadre du développement de la personne que l’on étiquettera plus tard sous le terme de « schizophrène ». David Coooper emploie souvent ce terme : « étiqueter », pour désigner le nouveau processus d’aliénation qui frappe la personne souffrante lors de son arrivée dans l’institution psychiatrique. C’est ici que le bât blesse : alors que la psychiatrie devrait prendre en charge le patient pour lui proposer une rédemption complète de ses dysfonctionnements psychiques, elle ne fait que perpétrer sur lui une aliénation et une violence initialement subies dans le milieu familial. La psychiatrie serait donc un instrument de la « normalité », utilisé pour légitimer la souffrance qui fut à la cause de la formation du trouble psychique. Ce paradoxe ultime expliquerait les causes des échecs nombreux connus dans le milieu de la psychiatrie : absence de résorption des troubles, récidives, réhospitalisations…
par David Cooper et ses confrères est la plus importante. En effet, leur ouverture d’esprit, caractérisée par une absence de certitudes qui ne les pousse pas à abuser de la
Après avoir défini ces dysfonctionnements et lancé la réflexion sur des termes novateurs, David Cooper relate ses expériences de psychiatrie alternative. On connaîtra peut-être le récit de Mary Barnes et son Voyage à travers la folie. Ce texte et l’essai de David Cooper se rejoignent puisque tous deux ont fait partie de l’expérience du Pavillon 21, un établissement anti-psychiatrique expérimental fondé à Londres dans les années 60. David Cooper et ses collègues mettent en place les bases d’un fonctionnement psychiatrique novateur qui ne se baserait plus sur une hiérarchie péremptoire de type médecin/patient, sur l’obligation de mener des activités constructrices ou sur un traitement répressif. David Cooper est lucide et n’affirme pas que cette expérience aura été révélatrice, ni qu’elle aura connu des succès fracassants. La prise en charge des personnes considérées comme schizophrène aura certes été plus efficace, mais elle aura également été marquée par des échecs et des désillusions. Là n’est pas le plus important toutefois, et il semble surtout que la démarche de réflexion menée position de supériorité que leur confèrent leurs titres de docteurs, les mène à considérer le patient sous un angle innovant : celui de la victime isolée d’un groupe de victimes associées. En d’autres termes, annoncés d’emblée dans son essai, David Cooper écrit :
« Ce que j’ai essayé de faire dans ce livre, c’est de regarder dans son contexte humain réel l’individu qu’on a étiqueté comme « schizophrène », de rechercher comment cette étiquette lui a été donnée, par qui elle a été posée, et ce que cela signifie, à la fois pour celui qui l’a posée et pour celui qui l’a reçue. »
Malgré des résultats contestables et une absence de relève immédiate, force est d’admettre que David Cooper et ses pairs ont éveillé des consciences et poussé à une nouvelle analyse des termes de la psychiatrie classique. Leurs réflexions, foncièrement dérangeantes à l’époque à la fois pour le domaine médical mais aussi pour le domaine social, ont peut-être mis du temps pour être acceptées et digérées mais on en retrouve aujourd’hui des germes dans certaines approches thérapeutiques du trouble mental.
Avec cet essai revigorant, traduction d’un esprit original –perturbé-, David Cooper nous prouve implicitement une des autres théories exposées dans son livre : la santé, lorsqu’elle se manifeste dans toute son ampleur, se situe dans une proximité étroite avec la folie. « Mais un blanc décisif, une différence, demeure toujours. C’est le point oméga. »
Une définition des caractéristiques retrouvées chez la plupart des familles des "schizophrènes" :
| Citation: |
|
« Dans les familles des patients schizophrènes, les intentions liées aux « actes psychotiques » du patient sont niées ou même se trouvent (par une sorte d’antithèse) retournées de manière
telle que les actions du patient prennent l’apparence d’un pur processus, coupé de toute praxis, et peuvent même être vécues par le sujet sous cette forme. Quand les choses arrivent là, le patient –celui qu’on a identifié comme tel- doit, afin de donner à sa vision du monde une certaine cohérence, une certaine « santé », inventer une représentation imaginaire de ces mystérieuses influences qui agissent sur lui. C’est ici que trouvent sens les « hallucinations » relatives à l’influence exercée par des sujets venus d’autres planètes, ou par des institutions plus proches, telles que l’Eglise catholique, le parti communiste ou les francs-maçons. » |
| Citation: |
| « Dans la famille du futur « schizophrène », nous observerons une sorte d’extrémisme particulier. Même les questions apparemment les plus banales sont articulées sur les pôles santé/folie, vie/mort. Les lois du groupe familial qui règlent non seulement le comportement mais aussi les expériences autorisées, sont à la fois inflexibles et confuses. Dans une telle famille, un enfant doit apprendre un certain mode de relation avec sa mère (par exemple), mode dont on lui enseigne que dépend entièrement son intégrité mentale et physique. On lui dit que s’il viole les règles, et l’acte autonome apparemment le plus innocent peut constituer une telle violation, il provoquera tout à la fois la dissolution fatale du groupe familial, la destruction de ce qui est la personnalité de sa mère, peut-être celle d’autres personnes encore. Du coup, […] il est progressivement placé dans une position intenable. Son choix, au dernier point critique, est entre la soumission totale, le complet abandon de sa liberté d’un côté, et d’un autre côté, le départ hors du groupe, avec l’angoisse d’assister à la dévastation prophétisée et de se heurter au sentiment de culpabilité qu’on lui a inculqué à travers tant de soin affectueux. » |
Dans cette tentative de cerner des traits communs, David Cooper fait apparaître la notion de "double contrainte" :
| Citation: |
|
« On a noté que le malade dit schizophrène avait dû à plusieurs reprises faire face à des exigences contradictoires dans sa famille, et parfois même à l’intérieur de l’hôpital psychiatrique. Certains chercheurs américains ont employé ici le vocable de « double contrainte ». […] on peut dès maintenant l’illustrer par l’exemple banal de la mère qui fait une déclaration contredite par sa conduite : elle dit à son fils : « Va, trouve toi-même tes propres amis et ne sois pas si dépendant de moi », mais en même temps elle montre (hors de toute verbalisation) qu’elle serait bouleversée s’il la quittait vraiment, fût-ce dans cette faible mesure. » |
Qu'il précise un peu plus loin dans son essai:
| Citation: |
|
« Les caractéristiques générales de cette situation (de double contrainte) sont les suivantes : 1. Quand un individu est engagé dans une relation intense ; c’est-à-dire une relation dans laquelle il sent être d’une importance vitale pour lui de distinguer avec précision quelle sorte de message lui est communiquée, afin de pouvoir y donner la réponse appropriée ; 2. et lorsque cet individu est mis dans une situation où son partenaire, à l’intérieur de la relation, émet deux ordres de messages dont l’un contredit l’autre ; 3. alors l’individu est incapable de commenter les messages émis pour mieux distinguer auquel des deux il doit répondre ; c’est-à-dire qu’il est incapable de formuler un jugement qui relève de la métacommunication. » |
Et une définition intéressante de l'individu dans son rapport au monde :
| Citation: |
| « Il y a d’abord les actes par lesquels une personne se présente elle-même à nous ; dans ces actes, nous décelons une ou des intentions qui se rattachent à un choix antérieur et plus fondamental de soi : cette présentation de soi (de soi qui est pur écoulement excédant perpétuellement la perpétuelle objectivation de soi dans le monde), c’est la dialectique constituée. D’une description phénoménologique de ce moment constitué, nous passons, par un mouvement régressif, à une dialectique constituante : par ce dernier terme, nous entendons tous les facteurs de conditionnement socio-environnementiels (intra-familiaux, extra-familiaux, socio-historiques, de classe économique) dans la plénitude de leur interpénétration. Mais nous ne pouvons en rester là. Par un mouvement progressif nous devons atteindre la synthèse personnelle, la totalisation totale –la totalisation unique faite par la personne de la totalisation conditionnante, sur la base de sa totalisation de soi. Nous avons alors atteint la « vérité » de la vie de la personne, ou d’un secteur particulier de cette vie. » |