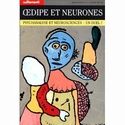Au départ, tout allait bien. La psychanalyse a fait son apparition sur le terrain encore relativement peu défriché de la maladie mentale –que l’on appelait encore « folie » pour ne pas se casser
la tête et parce que la répertoriation de toutes les différentes modalités d’expression du « fou » n’avait pas encore été réalisée. Et puis, le 20e siècle s’est emballé avec son lot de
découvertes. Pharmacologiques pour le domaine de la psychiatrie, biologiques pour le domaine des neurosciences –si l’on cherche à résumer. Mais réduire les trois disciplines à des domaines aussi
fermés, n’est-ce pas simplifier à outrance leur domaine d’action, au risque de négliger leurs influences réciproques, et empêcher dès lors leur réunion dans l’obtention d’une synthèse réussie qui
permettrait peut-être d’ouvrir à de nouveaux horizons les points de vue sur la maladie mentale ?
Le 20e siècle est vite passé, qui n’a pas vraiment permis de se laisser le temps de réfléchir à cette question. Et si le bilan est aussi mitigé, la faute est surtout celle des spécialistes : pris
au piège du dogmatisme de leur profession, ne jurant que par écoles, courants et mouvements, définis ou non par des diplômes ou des affiliations, il leur est parfois difficile de prendre en
considération des concepts, pensées ou opinions qui ne relèvent pas de leur domaine. La faute aux idéologies, mais aussi à la complexification croissante des disciplines qui ne permet pas de
s’approprier toutes les connaissances les plus pointues de chacune d’entre elles. En sciences comme partout ailleurs, il faut faire des choix, c’est-à-dire se spécialiser, et accepter de n’avoir
pas une maîtrise absolue de disciplines convergentes qui pourraient pourtant enrichir le point de vue.
Dans Œdipe et Neurones, ouvrage collectif supervisé par Béatrice Boffety, des intervenants des domaines susmentionnés sont invités à délivrer leurs points de vue. Leur sélection
est très pertinente et les points de vue professionnels et passionnés de chacun permettent de découvrir des imbrications insoupçonnées et des pans de l’histoire des disciplines qui ne se seraient
sans doute pas dévoilés avant longtemps sans la lecture de cet ouvrage. Œdipe et Neurones est un titre qui résume d’ailleurs très bien le travail de réflexion engagé à travers
cette collaboration d’auteurs, et on découvre comment, les premiers, les mythes grecs ont su constituer un freudisme avant l’heure du fait de leur richesse symbolique. Grand bon dans le futur et
apparition de la psychanalyse et de ses dérivés, puis découvertes pharmacologiques qui permettent de prendre en charge des patients en situation d’urgence, puis banalisation de ces mêmes
psychotropes. N’oublions pas les découvertes neurobiologiques parallèles qui s’insinuent au cœur même du fonctionnement de l’individu, dans l’intimité de ses neurones. Mais n’allons pas trop
vite, et ne sautons pas cette période obscure de la « folie » médiévale, parfois confondue avec son penchant, la « sorcellerie ». Nous apprendrons donc comment, peu à peu, la folie s’est dégagée
de cette stigmatisation ésotérique et comment s’est affiné le regard que l’on porte sur elle. D’abord hystérie, mot fourre-tout parfait pour glisser en vrac n’importe quelle caractéristique qui
fait glisser l’individu de la norme à l’anormal, on a ensuite séparé la névrose de la psychose –bien que l’on ne soit plus certain, aujourd’hui, de la pertinence de cette séparation- avant
d’établir une nosologie pointue qui aboutira au manuel de référence du DSM.
Dans cette première partie, si préjugés il y avait encore, ils disparaîtront : où l’on apprendra que la définition de la folie répond également au théorème de la relativité et qu’elle est surtout
une question de culture.
« Les choses ne sont pas si simples pour autant, car c’est l’extension de la notion du réel qui varie, selon les époques et les systèmes, alors que la notion de folie –comme inadéquation entre une conscience et le réel, semble, elle, rester fixe. In fine, il convient donc de s’interroger non pas tant sur la façon qu’a une société à un moment donné de se représenter la folie, mais sur les frontières qu’elle donne à la notion de réel. » (Béatrice Boffety)
La deuxième partie de l’ouvrage présente les différentes disciplines que sont la psychanalyse, la psychiatrie et les neurosciences. Des spécialistes s’expriment et donnent leurs points de vue sur
leur discipline, les raisons qui les encouragent à croire en la pertinence de leurs recherches et les intérêts qu’ils y décèlent pour la prise en charge et le traitement des personnes en
souffrance psychologique. Ces apports ne sont pas des charges à visée de prosélytisme. Les auteurs n’hésitent pas à exprimer leurs doutes ou à reconnaître des influences extérieures qui ont su
enrichir les recherches de leurs domaines. Surtout, les points de vue sont originaux : en citant des exemples qui semblent parfois à mille lieux de la maladie mentale, ils permettent de
comprendre la complexité de l’être humain et, allant, la difficulté que revêt la possibilité d’agir ou non sur son comportement. On découvrira par exemple quels sont les processus impliqués dans
la régulation de la faim (Jacques Le Magnen), comment peut naître une pensée à partir d’une mécanique neuronale (Stanislas Dehaene), quels sont les paradoxes de la mort cellulaire (François Gros)
ou encore ce qui définit la pulsion, de la biologie à l’économie (Alain Gibéault).
En troisième partie, le corpus se scinde en plusieurs discours : l’un concerne la névrose et cherche à comprendre son degré de déterminisme, sa prise en charge et la thérapie psychanalytique ; le
deuxième concerne la psychose maniaco-dépressive et la schizophrénie ; le troisième s’attarde davantage sur la psychosomatique à travers les exemples de la maladie de Crohn, de la fibromyalgie,
de l’épilepsie et des cancers ; le quatrième, enfin, s’attarde sur le cas particulier des maladies mentales infantiles avec une focalisation particulière sur le cas de l’autisme.
La dernière partie d’Œdipe et Neurones constitue une ouverture à la réflexion amorcée au cours de la lecture. Après s’être tourné sur le passé et avoir cherché à comprendre
comment s’est menée la lente constitution du paysage de la maladie mentale aujourd’hui, les auteurs se tournent vers l’avenir et essaient de deviner ce que sera la prise en charge des troubles
psychiques à l’avenir. Va-t-on vers un tout-biologique plus prégnant, avec le développement des neurosciences ? Consommera-t-on tous, de manière généralisée, davantage de psychotropes ? Ou
disparaîtront-ils au contraire, au profit d’une meilleure connaissance de l’être humain –connaissance qui passe justement par une meilleure compréhension de ses mécanismes cérébraux, entre
autres. Faut-il réformer la formation des psychanalystes ? Modifier la prise en charge des patients ? De quelle manière l’argent intervient-il dans les rapports entre patient et analyste ? Sur
des questions d’apparence anodine, les auteurs nous montrent, encore une fois, qu’aucun changement n’est anodin et détermine une certaine manière de considérer le traitement thérapeutique.
Œdipe et Neurones est un ouvrage passionnant et foisonnant, qui s’adresse aussi bien à l’initié –qui trouvera sans doute son compte dans le lot des apports originaux et novateurs
des auteurs- qu’à l’amateur –dont la clarté des auteurs mettra à sa portée des notions et des théories souvent inattendues. Psychanalyse, psychiatrie et neurosciences se recoupent et apparaissent
finalement beaucoup plus liées qu’il n’y paraît. Oui, mais c’est aussi et surtout l’être humain qui est pris au piège au centre de ces disciplines, et s’intéresser à leur évolution conjointe,
c’est finalement et surtout se préoccuper de l’évolution de la place donnée à l’homme dans un monde où l’on exige de lui toujours plus de performance et d’excellence –parfois et trop souvent
au-delà de ses limites naturelles.
Ce livre m'aura entre autres donné envie de lire Henri Laborit et son Eloge de la fuite après lecture de son intervention dans l'ouvrage :
| Citation: |
|
« […] pour moi, toute la pathologie dépend de la façon dont on peut ou non contrôler son environnement par l’action. J’avais trouvé, entre 1970 et 1974 […] que, lorsqu’il y a inhibition de l’action, il y avait augmentation de la cortisolémie. Tout le monde sait également que le cortisol détruit le système immunitaire. […] Le système vasculaire est rétréci, contient trop de liquides et toute une pathologie en dépend (hypertension, infarctus). Maintenant, en ce qui concerne l’inhibition du système immunitaire, on appelle cela la « neuro-immunomodulations ». J’ai d’abord mis en évidence les aires cérébrales qui aboutissaient à ce que j’ai appelé l’ « attente en tension » du moment où l’on peut agir. Si ça ne dure pas longtemps, ça va ; et cela peut même parfois vous sauver la vie. Mais si par exemple vous êtes ouvrier chez Renault, que la tête du contremaître ne vous revient pas, vous ne pouvez pas lui casser la figure parce que l’on vous poursuivrait ; vous ne pouvez pas fuir parce que vous seriez au chômage ; vous ne pouvez pas lutter. Vous êtes en inhibition d’action. Vous libérez alors vos glucocorticoïdes et détruisez votre système immunitaire : les ennuis arrivent. » |
Des considérations sur le travail de mélancolie de Benno Rosenberg :
| Citation: |
|
« C’est une des découvertes importants de Freud que d’avoir compris que le mélancolique qui se mésestime, se dévalorise, se rabaisse soi-même, s’adresse en réalité à l’objet en utilisant le
fait que l’objet est en lui-même puisqu’il l’a introjecté, puisqu’il s’est identifié à lui. […] Nous avons vu que le travail de mélancolie a pour but de liquider l’investissement narcissique de l’objet, de l’objet perdu. Or, l’investissement narcissique de l’objet est lié à l’idéalisation de l’objet, chez le mélancolique à coup sûr, et par conséquent attaquer l’idéalisation de l’objet, dévaloriser l’objet, c’est rendre impossible de continuer à l’investir narcissiquement. D’autre part, et en opposition parfaite avec le discours conscient du mélancolique, le sujet mélancolique finit par se reconnaître (inconsciemment bien entendu) comme supérieur à l’objet. C’est par ce double mouvement –dans lequel l’objet dévalorisé est le sujet implicitement valorisé par rapport à l’objet –que se crée la distance entre les deux, laquelle rend impossible la continuation de l’investissement narcissique d’objet, qui les éloignerait l’un de l’autre. Tout ceci, comme nous le savons, est lié à une souffrance inouïe pour le sujet mélancolique. Mais il faut dire que la souffrance ne consiste pas seulement dans le fait que le sujet mélancolique est obligé de s’attaquer soi-même pour attaquer l’objet (introjecté) : la souffrance consiste aussi, sinon surtout, dans la déchirure du lien étroit (narcissique dans le plein sens du mot) qui les reliait auparavant. C’est une véritable torture, comparable à une amputation, que le mélancolique s’inflige à lui-même, mais c’est aussi, et par là même, la rupture avec l’objet perdu, et donc la sortie de l’accès mélancolique. » |
reste à savoir si la date de publication de l'ouvrage ne le rend pas trop obsolète aujourd'hui...
*images de Gaston Chaissac