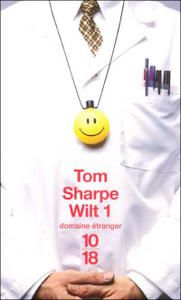Ce livre tiré de l’expérience de Soljenitsyne est en partie autobiographique. Au début de la déstalinisation, en 1955, Soljenitsyne est exilé au Kazakhstan après huit ans de goulag et il apprend
qu’il est atteint d’un cancer, dont il se remettra miraculeusement.
Dix ans plus tard, Soljenitsyne commence à rédiger Le pavillon des cancéreux dans lequel il relate son expérience à travers un éventail de personnages issus de milieux variés et
aux conditions sociales différentes, afin de de peindre le tableau social de ces années de la déstalinisation.
Sur 700 pages, sans aucun parti pris, Soljenitsyne nous laisse le temps de nous attacher aux personnages et de nous faire les spectateurs des débats idéologiques entre communistes chevronnés et
victimes des goulags, entre l’infirmière totalement dévouée à son métier et celle, plus naïve, qui écoute son cœur avant de se tourner vers les rudiments de son apprentissage en médecine.
Cette foule bigarrée se retrouve finalement dans le pavillon des cancéreux, où toute trace de différence est abolie. Ici, chacun est empêtré dans une situation identique : la lutte contre le
cancer. La vie ralentit, rythmée seulement par les séances de radiation, les rendez-vous avec les médecins, les visites des proches et les discussions avec les autres malades.
« Il avait fallu la petite boule dure d’une tumeur inattendue, insensée, parfaitement inutile, pour qu’on l’entraînât ici, comme un poisson à l’hameçon, et qu’on le jetât sur ce lit de fer
étroit, pitoyable avec sa toile métallique grinçante et son matelas efflanqué. Il lui avait suffi de se changer, sous l’escalier, de dire adieu à sa femme et à son fils, et de monter dans cette
chambre pour que toute sa vie d’avant, harmonieuse, réfléchie, se fermât, comme une porte qui claque, supplantée brusquement par une autre vie, si abominable qu’elle lui faisait plus peur encore
que sa tumeur même. Il ne lui était plus loisible désormais de poser les yeux sur quoi que ce fût d’agréable, d’apaisant ; il lui fallait contempler huit malheureux, devenus ses égaux,
semble-t-il, huit malades en pyjamas blancs et roses déjà passablement défraîchis et usés, rapiécés ici, déchirés là, trop petits pour l’un, trop grands pour l’autre. »
Ce livre me parle tout particulièrement, puisqu’il relate l’expérience de l’enfermement, sans jamais tomber dans la facilité de l’apitoiement ou dans le bonheur naïf d’une promesse de guérison
inéluctable.
« Cet automne-là, j’ai appris que l’homme peut franchir le trait qui le sépare de la mort tout en restant dans un corps encore vivant. Il y a encore en vous, quelque part, du sang qui coule
mais, psychologiquement, vous êtes déjà passé par la préparation qui précède la mort et vous avez déjà vécu la mort elle-même. Tout ce que vous voyez autour de vous, vous le voyez déjà comme
depuis la tombe, sans passion, et vous avez beau ne pas vous mettre au nombre des chrétiens, et même parfois vous situer à l’opposé, voilà que vous vous apercevez tout à coup que vous avez bel et
bien pardonné à ceux qui vous avaient offensé et que vous n’avez plus de haine pour ceux qui vous ont persécuté. Tout vous est devenu égal, voilà tout ; il n’y a plus en vous d’élan pour réparer
quoi que ce soit ; vous n’avez aucun regret. Je dirai même que l’on est dans un état d’équilibre, un état naturel, comme les arbres, comme les pierres. Maintenant, on m’a tiré de cet état, mais
je ne sais pas si je dois m’en réjouir ou non. Toutes les passions vont revenir, les mauvaises comme les bonnes. »
« Rabinovitch était un malade qui venait à la consultation ; il en était au moins à sa deux centième séance ; chacune d’elle lui était pénible et il sentait que chaque dizaine d’irradiations
le rapprochait moins de la guérison que de la mort. Là où il vivait, dans son appartement, dans sa maison, dans sa ville, personne ne le comprenait : tous ces gens bien portants couraient du
matin au soir, pensant Dieu sait quels succès ou à quels échecs, qui leur paraissaient très importants. Même sa famille en avait assez de lui. Il n’y avait qu’ici, sur le petit perron du
dispensaire anticancéreux qu’on l’écoutât pendant des heures et que l’on compatît à son sort ; chaque malade en effet comprenait ce que cela veut dire lorsque le trigone souple du cartilage
thyroïdal s’est complètement durci et que tous les endroits irradiés portent des cicatrices considérablement épaissies… »
Soljenitsyne nous permet d’effectuer une formidable traversée de la psychologie de chacun de ses personnages. Leurs sentiments et leurs contradictions sont analysés avec une acuité perçante.
Soljenitsyne fait preuve d’une humanité remarquable et ne dévalorise jamais ses personnages, leurs travers, vices et mensonges étant toujours les conséquences regrettables d’une lutte qu’ils
n’arrivent pas à mener dans l’objectif de donner un sens à leur vie. Malgré tout ce qui leur tombe sur les épaules, malgré le sentiment d’immense injustice que peut leur inspirer cette succession
d’évènements nauséabonds qui a formé leur vie depuis leur naissance jusqu’à l’éclosion de leur cancer, l’espoir n’est jamais bien loin, et ce message est d’autant plus fort qu’il jaillit au cœur
de ce lieu morbide qu’est le pavillon des cancéreux.
« Ce n’est pas le niveau de vie qui fait le bonheur des hommes mais bien la liaison des cœurs et notre point de vue sur notre vie. Or l’un et l’autre sont toujours en notre pouvoir, et
l’homme est toujours heureux s’il le veut, et personne ne peut l’en empêcher. »
« Eh bien, voilà ce que c’est que le socialisme moral : ne pas lancer les hommes à la poursuite du bonheur car le bonheur c’est encore une idole du commerce, mais leur proposer comme but la
bienveillance mutuelle. Heureux, l’animal qui déchiquette sa proie l’est aussi, tandis qu’il n’y a que les hommes qui puissent être bienveillants les uns envers les autres. Et c’est là ce que
l’homme peut viser de plus haut. »
L’espoir, chez Kostoglotov par exemple, se cristallise entièrement dans la journée qui lui permettra enfin de retrouver sa liberté, à l’extérieur de la clinique. Après un moment d’ivresse,
Kostoglotov redécouvre la réalité du monde extérieur, tel qu’il l’avait abandonné, et toute l’absurdité de son existence, ni meilleure dans la maladie, ni meilleure dans la bonne santé, se révèle
à lui.
« Les poules ont beau savoir que chacune d’elles aura le couteau en travers de la gorge, elles n’en continuent pas moins à glousser et à grattouiller pour trouver leur nourriture. Et on peut
bien en prendre une pour l’égorger, ça n’empêchera pas les autres de grattouiller. »
Une pensée de Soljenitsyne qui s’applique admirablement au contenu du Pavillon des cancéreux :
| Citation: |
| « C’est terrible à penser, mais alors toutes nos vies sacrifiées, nos vies boiteuses, et toutes ces explosions de nos désaccords, les gémissements des fusillés et les larmes des épouses –est-ce que tout cela aussi sera oublié tout à fait ? est-ce que tout cela aussi donnera la même beauté éternelle et achevée ? » |
Alexandre Soljenitsyne dans Etudes et Histoires minuscules






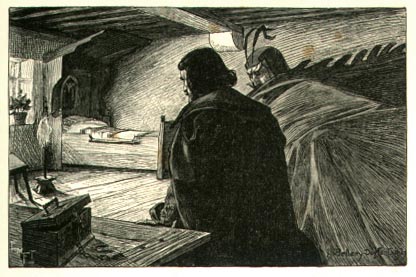



 .
.
 )
)


 ), un passage
où Robbins s’emballe carrément ! Un peu excessif le bonhomme mais il ce doit être son côté flatteur-gentleman
), un passage
où Robbins s’emballe carrément ! Un peu excessif le bonhomme mais il ce doit être son côté flatteur-gentleman