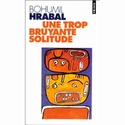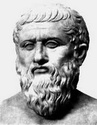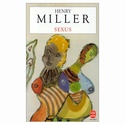Le Guide du Voyageur Galactique est connu par la quasi-intégralité de l’Univers. Arthur, représentant de l’humanité, a pourtant dû attendre la destruction de sa planète pour en
découvrir l’existence. Est-ce à dire que nous, pauvres terriens, sommes un peu paumés au milieu de cet infini Univers ?
Peut-être, mais nous ne sommes certainement pas les pires puisque nous avons au moins conscience qu’il existe autre chose dans l’univers. Une évidence ? Pas pour les habitants de la
planète Krikket en tout cas... Leur monde est entouré d’un nuage opaque qui les empêche d’imaginer qu’il puisse exister un au-delà galactique. Lorsqu’un vaisseau vient s’écraser sur le sol de
leur planète, la stupéfaction les saisit. Ni une, ni deux, comme s’ils n’attendaient que cette distraction pour s’ouvrir à l’inconnu, ils rattrapent en quelques mois tout le retard scientifique
dû à leur ignorance. Leur instinct d’imitation leur permet de rafistoler un vaisseau à la ressemblance du premier et de s’aventurer du côté de leur grand ciel gris… qu’ils s’empressent aussitôt
de traverser, découvrant avec stupéfaction l’existence de tout un Univers qu’ils ne parviennent pas immédiatement à nommer faute de terme approprié. Eblouis par tant d’infini, étourdis devant la
perspective de tant de nouveaux mondes se présentant à eux, les habitants de la planète Krikket n’ont désormais plus qu’une idée : détruire le reste de l’univers !
Les Krikket menacent la vie. Qui appelle-t-on à la rescousse ? Arthur, Ford et Slartibartfast chevauchent leur vaisseau écologique (il est propulsé à l’aide d’un générateur d’improbabilité qui
use de la relativité des nombres inscrits sur les additions des tickets de restaurant) pour se lancer dans une grande contre-attaque qui permettra de rendre inoffensifs les habitants de la
planète Krikket.
Ouf. Ce n’est pas de tout repos, et après deux premiers tomes plutôt reposants, Douglas Adams accélère la cadence en nous proposant une intrigue ficelée comme un gigot d’agneau –tellement ficelée
qu’on s’y laisse parfois embobiner, et un sursaut d’inattention nous obligera à retourner quelques dix pages en arrière pour mieux comprendre les détours retors empruntés par l’intrigue (une
redite du voyage spatio-temporel ?). Du coup, le rire disparaît derrière ces dégringolades d’actions en tous genres –sauf un sursaut surgi après la lecture d’un calembour que Douglas Adams
n’oublie pas de parsemer au fil de ses pages. Il n’empêche, la place accordée aux conseils absurdes du Guide du Voyageur Galactique se fait pâlotte. Le burlesque s’efface au
profit de l’aventure et l’aventure –même déjantée- ne permet pas les spéculations dingues que Douglas Adams s’accordait dans les épisodes précédents.
Lorsqu’on fait trop bien, il est difficile, ensuite, de faire mieux. L’ascension de Douglas Adams sur l’échelle du rire et de l’absurde ne pouvait pas être infinie –n’est pas l’Univers qui veut.
Cette légère baisse de régime du troisième volume ne le rend toutefois pas contournable. Toujours excellent dans le domaine du loufoque, il est seulement moins bon que les précédents livres
auxquels Douglas Adams nous avait habitués. Une légère déception, de temps en temps, ne fait pas de mal : un petit coup de baisse de régime et c’est reparti, à qui mieux-mieux pour le quatrième
épisode !
Pour ceux que ça intéresse... ![]() des extraits tordants digne d'un Douglas
Adams en pleine forme !
des extraits tordants digne d'un Douglas
Adams en pleine forme !
Le passage excellent sur la longueur insupportable des dimanche après-midi :
| Citation: |
| « Sur la fin, c’étaient les dimanches après-midi qu’il avait commencé à ne plus encaisser, avec ce terrible désœuvrement qui vous saisit sur le coup des quatorze heures cinquante-cinq, quand vous savez que vous avez déjà pris tous les bains que vous pouviez prendre ce jour-là, quand vous savez que vous aurez beau vous écorcher les yeux sur les articles du journal, quelques qu’ils soient, vous n’arriverez jamais à les lire vraiment, ni à appliquer cette révolutionnaire nouvelle technique de taille des arbres qu’on y décrit, quand vous savez que, tandis que vous contemplez la pendule, les aiguilles s’avancent inexorablement vers le chiffre quatre, funeste présage de cette languissante heure du thé, triste tasse pour les âmes. » |
Le concept du CLEP -encore une belle trouvaille d'Adams :
| Citation: |
| « Un CLEP […] est une chose que l’on ne peut pas voir, ou qu’on ne veut pas voir, ou que notre cerveau nous empêche de voir, parce qu’on s’imagine que c’est leur problème et pas le nôtre. C’est exactement ce que veut dire CLEP : C’est Leur Problème. Et le cerveau le censure, tout simplement. Comme s’il faisait un blanc. Si tu le regardes directement, tu ne pourras pas le voir, tant que tu ne sauras pas exactement ce que c’est. Ton seul espoir, c’est d’essayer de l’entrevoir par surprise du coin de l’œil.» |
Enfin, pour les plus rêveurs d'entre nous... comment apprendre à voler ?
| Citation: |
|
« Il existe un art, ou plutôt un truc, pour voler. Le truc est d’apprendre à se flanquer par terre en ratant le sol. Choisir de préférence une belle journée pour s’y essayer. […] La plupart des gens n’arrivent pas à rater le sol et s’ils s’y sont bien pris, il est probable qu’ils n’arriveront pas à le rater assez durement. […] Le problème est en effet qu’il faut parvenir à rater le sol accidentellement. Inutile de vouloir délibérément rater le sol : ça ne marchera pas. Il faut avoir l’attention subitement distraite à mi-parcours, de manière à ne plus penser à la chute au sol, ou à quel point ça va faire mal si on manque de le rater. Il est notoirement difficile de détourner son attention des trois susdits éléments durant la fraction de seconde dont on dispose. D’où l’échec constaté chez la majorité des gens et leur conséquente déception quant à la pratique de ce sport pourtant exaltant et spectaculaire. » |