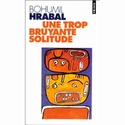Y avait-il besoin, en 1921, de faire paraître un énième ouvrage sur le Christ ? S’il n’avait pas été écrit par Giovanni Papini, on aurait pu en douter. Mais lorsque le grand maître, remueur de
pensées, profondément sincère et attaché à ses convictions, revient à la source de sa foi pour retracer les contours d’un christianisme vigoureux, l’entreprise devient non seulement nécessaire
mais salutaire.
Revenant sur l’Histoire du Christ telle qu’elle est narrée dans les Evangiles, se débrouillant avec les seuls moyens de sa compréhension et de son intellect, Giovanni Papini met de côtés toute
exégèse et croyance antérieures pour se plonger entièrement dans les sources du christianisme. Alors qu’il était loin de s’en douter, il découvre un Christ dont l’image de simplicité
bienveillante l’éblouit.
L’Histoire du Christ n’est pas un livre de prosélytisme ; Papini n’espère même pas se faire comprendre par le lecteur qu’il assimile à ces millions d’auditeurs distraits du
Christ qui, au fils des siècles, n’ont jamais réussi à entendre le Prophète. Son livre est une démarche d’amour qui s’inscrit en filiation directe avec le message promulgué par le
Christ. Déçu par la monotonie et l’ennui distillés par les textes de religieux, par l’hypocrisie cupide qui émane des ouvrages prosélytes, Giovanni Papini a désiré rendre hommage au Christ et à
la beauté véhiculée par ses propos à travers une biographie fidèle, restituée par le biais d’une écriture simple mais puissante. Qu’à cela ne tienne si d’autres ne seront pas d’accord avec lui :
Giovanni Papini s’investit totalement dans ce récit qui est aussi celui de sa conversion et n’hésite pas à se lancer dans des diatribes féroces contre le désenchantement du monde moderne, contre
la lie du peuple et contre les mesquineries qui font le commun des mortels. Si on avait craint de perdre la férocité que l’écrivain avait pu déployer dans Gog, on la retrouve
ponctuellement lorsqu’il s’agit de défendre des valeurs que le monde moderne et ses « principes » ont préféré oublier.
| Citation: |
| « Aujourd’hui les hommes sont plus ivres qu’alors mais plus altérés. Aucun âge plus que le nôtre n’a éprouvé la soif dévorante d’un salut surnaturel. En aucun temps l’abjection n’a été si abjecte, la brûlure si brûlante. La terre est un enfer illuminé par la condescendance des astres. Les hommes sont plongés dans une poix faite d’ordures et de larmes, dont parfois ils émergent, défigurés et frénétiques pour se jeter dans le sang avec l’espoir de s’y laver. » |
On peut adhérer ou non au message chrétien, peu importe. L’Histoire du Christ, dont l’intérêt historique pourra déjà suffire à la lecture, propose également une violente critique
des sociétés modernes fondées sur la négation de la foi et la glorification de « la suprême trinité de Wotan, Mammon et Priape ». Giovanni Papini, qui jusque-là avait semblé d’un cynisme et d’un
désespoir sans remèdes –il suffit de lire Gog ou La Vie de Personne- nous dévoile le fondement de sa virulence parfois presque agressive. C’est parce qu’il
attend trop de ses congénères que, sans cesse déçu, il se plaît à en caricaturer les défauts dans ses écrits. Mais là où il aurait pu finir par se complaire sans sublimer son agressivité,
Giovanni Papini trouve un remède dans la foi chrétienne et s’avoue à révéler ses véritables sentiments. Son écriture surprend puisque, pour une fois, il ne prendra pas ses airs de nihiliste pour
faire réagir les plus disposés de ses lecteurs, mais il s’abandonnera au contraire à l’amour.
| Citation: |
| « Jésus ne pose pas d’énigmes. Lui-même a dit à la fin de la parabole qu’il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur repenti que pour tous les justes qui se font gloire de leur bâtarde justice, pour tous les purs enorgueillis de leur pureté extérieure, pour tous les dévots zélés qui cachent l’aridité de leur cœur sous l’apparent respect de la loi. » |
L’Histoire du Christ, sincère et adaptée aux conditions de la modernité, détache le Prophète de ses icônes poussiéreuses pour lui conférer une nouvelle dignité. L’adhésion au
message chrétien ne se fera pas forcément à l’issue de cette lecture mais il y a fort à parier qu’elle fera renaître l’espoir d’un monde tourné à l’introspection et à l’amélioration, et qu’elle
permettra aux plus athées ou agnostiques d’entre nous de considérer la foi non plus comme une croyance absurde mais comme une démarche salvatrice conférant du sens à un monde bâti sur des sables
mouvants.
La préface de Papini éclaire sur sa démarche.
Il commence en tournant en dérision ceux qui se proclament comme les nouveaux "ennemis de Dieu" :
| Citation: |
|
« A peine sembla-t-il que la seconde agonie en fût aux avant-derniers râles, les nécrophores se présentèrent, buffles présomptueux qui avaient pris les bibliothèques pour des étables ; aérostatiques cervelles qui, grâce au ballon volant de la philosophie, croyaient atteindre les sommets du ciel, professeurs exaspérés par de dangereuses débauches de philologie et de métaphysique, tous s’armèrent –l’Homme le veut !- comme autant de croisés contre la Croix. » |
Des êtres gonflés d'illusion :
| Citation: |
| « Et voici la troupe des porte-flambeaux et des badigeonneurs de l’esprit venus pour fabriquer des religions à l’usage des irréligieux. Durant tout le XIXe siècle, ils les sortirent du four par douzaines : Religion de la Vérité, de l’Esprit, du Prolétariat, du Héros, de l’Humanité, de la Patrie, de l’Empire, de la Raison, de la Beauté, de la Nature, de la Solidarité, de l’Antiquité, de l’Energie, de la Paix, de la Douleur, de la Pitié, du Moi, du Futur et ainsi de suite. Certaines n’étaient que rapetassages d’un christianisme découronné et désossé, d’un christianisme sans Dieu ; la plupart étaient des doctrines politiques ou des philosophies s’efforçant de se transmuer en mystiques. Mais les fidèles étaient rares et faible l’ardeur. Ces froides abstractions, même soutenues par des intérêts sociaux ou des passions littéraires, ne suffisaient pas aux cœurs dont on avait voulu arracher le Christ. » |
| Citation: |
| « Jésus au contraire est vivant en nous. Il se trouve des hommes pour l’aimer et pour le haïr ; pour souffrir de sa passion, pour s’acharner à le détruire ; et cet acharnement dit qu’il n’est pas mort. Ceux mêmes qui s’épuisent à nier sa doctrine et son existence passent leurs jours à rappeler son nom. L’ère du Christ est la nôtre et elle dure encore. » |
Qui ont mal interprété le message de Jésus. Papini cherche à leur transmettre sa propre compréhension. La parole de Jésus n'est plus porteuse de promesses seulement religieuses. Sa portée est
presque métaphysique.
| Citation: |
| « On dit que Jésus est le prophète des faibles et au contraire, il vient rendre force aux languissants et élever les piétinés au-dessus des rois. On dit que sa religion est celle des malades et des moribonds, mais il guérit les infirmes et ressuscite les dormants. » |
Dans cette Histoire du Christ, Papini ne perd pas son habilité à dresser des portraits minutieux qui mettent en avant les failles de chacun :
| Citation: |
| « Le converti, lui, cache toujours une inquiétude. Une goutte amère demeurée aux lèvres, une ombre d’immondice, le soupçon d’un regret, le souffle d’une tentation suffisent à renouveler son angoisse. Il garde toujours la crainte de n’avoir pas dépouillé la dernière peau du vieil homme ; de n’avoir qu’étourdi et non tué l’autre qui habitait son corps. Il a payé pour son salut ; il a souffert ; c’est pour lui un bien précieux et fragile qu’il a toujours peur de perdre ; il ne fuit pas les pécheurs, mais il les approche avec un involontaire frisson ; avec la terreur parfois inavouée d’une contagion nouvelle ; avec la crainte de voir renaître, au spectacle de la souillure où lui aussi se complut, le fantôme insupportable de sa honte est d’avoir à désespérer encore de son salut. » |
Ces passages "cruels" sont compensés par des morceaux lyriques qui révèlent une autre facette de Papini :
| Citation: |
| « Qui l’a lu une fois [Le Sermon sur la Montagne] et n’a pas senti, au moins pendant le court moment de cette lecture, un frisson de reconnaissante tendresse, le désir d’un sanglot au fond de la gorge, une angoisse d’amour et de remords, le besoin confus mais poignant de faire quelque chose pour que ces mots ne soient pas que des mots, pour que ce discours ne soit pas qu’un bruit et un signe mais un imminent espoir, la vie de tout vivant, vérité présente, éternelle vérité –qui l’a lu une seule fois et n’a pas éprouvé tout cela, mérite plus que tout autre notre amour, car tout l’amour des hommes ne compensera jamais ce qu’il a perdu. » |
Et pour finir, un autre exemple de la critique des sociétés modernes comme destructrices des valeurs fondamentales promulguées par Jésus (la raison ?) :
| Citation: |
| « Toutes les croyances, dans ce marasme infect, dépérissent et meurent. Une seule religion domine le monde : celle qui reconnaît la suprême trinité de Wotan, Mammon et Priape. La Force qui a pour symbole l’Epée et pour temple la Caserne ; la Richesse, qui a pour symbole l’Or et pour temple la Bourse ; la Chair qui a pour symbole le Phallus et pour temple le Bordel. Telle est la religion régnante sur la terre, pratiquée, sinon professée, par tous les vivants. L’antique famille se désagrège, le mariage est détruit par l’adultère et la bigamie ; avoir des enfants paraît à beaucoup une malédiction qu’il faut éviter par toutes les fraudes et par les avortements volontaires : la fornication supplante les amours légitimes ; la sodomie a ses panégyristes et ses lupanars ; les courtisanes publiques et secrètes gouvernent un peuple immense de crevés et de syphilitiques. » |