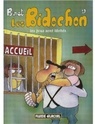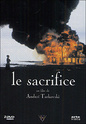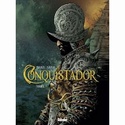Quinze années d’une existence peuvent paraître longues. Si on demandait à chacun d’en résumer les évènements, les rencontres et les pensées afin d’en tirer l’analyse d’une évolution individuelle,
on imagine facilement qu’il y aurait de quoi remplir un bon feuillet de pages. Quid alors de quinze années notifiées au jour le jour ? Pour Cesare Pavese, il n’est pas nécessaire de remplir une
somme au volume extravagant. Quatre cent pages suffisent amplement à l’écrivain pour s’analyser au cours de cette période.
Cesare Pavese s’engage pour le
métier de vivre en 1935, à l’âge de 28 ans, et s’y tient jusqu’à sa mort –une démission par suicide- en 1950. Pas forcément régulier, faisant
parfois preuve d’un absentéisme tenace lorsqu’il délaisse carrément son
Métier de vivre pour de longs mois, sans justification ni explication, il nous permet de suivre
l’évolution de sa carrière d’écrivain, du grand inconnu qu’il était encore en 1935, à l’homme de lettres reconnu qu’il devint au fil des ans, particulièrement au faîte dans les années 1948-1949.
A croire que la gloire littéraire ne peut pas faire tout le bonheur d’un homme qui misait pourtant sur la reconnaissance de sa nature « poétique » lorsqu’il était encore jeune… Et de constater
que plus Cesare Pavese trouvera confirmation de son talent, moins il s’évertuera à se proclamer poète, rêve naïf et halluciné d’un jeune homme qui croyait alors pouvoir trouver le bonheur de
l’accomplissement à travers l’écriture. A cette époque, les poses se multiplient. Agaçantes, elles donnent à voir un jeune homme qui semble prétentieux –si nous ne poursuivions pas notre lecture
au fil des années pour découvrir ce qui se cachait en réalité derrière ces velléités.
« Un poète se plaît à s’enfoncer dans un état d’âme et il en jouit ; voilà la fuite devant le tragique. Mais un poète devrait ne jamais oublier qu’un état d’âme
pour lui n’est encore rien, que ce qui compte pour lui c’est la poésie future. Cet effort de froideur utilitaire est son tragique »
La reconnaissance littéraire venant, Cesare Pavese cessera de se complaire dans ces poses fantasmées. Son rêve s’est accompli, c’est-à-dire qu’il s’est détruit et qu’il lui accorde à peine la
satisfaction nécessaire pour continuer à survivre. Tel est le malheur que Cesare Pavese nous révèle du bout de la plume à travers ses confessions.
« Le problème n’est pas la dureté du sort, puisque l’on obtient tout ce que l’on veut avec une force suffisante. Le problème, c’est plutôt que ce que l’on
obtient dégoûte. Et alors, on ne doit jamais s’en prendre au sort, mais à son propre désir. »
Cette difficulté, Cesare Pavese la retrouve aussi –et surtout- dans sa vie sociale. Que les amis soient une source d’ennui passe encore : l’écrivain sait se donner toutes les apparences de la
cordialité, et le bonheur qu’il dit éprouver lorsqu’il se retire enfin du cercle des mondanités compense tous les désagréments. Mais lorsqu’il s’agit des femmes… Cesare Pavese avoue aimer comme
un éternel adolescent et se lamente, au fil des ans, de ne pas savoir apprendre de ses erreurs sentimentales et d’éprouver dans ce domaine les mêmes sentiments contradictoires que dans la
reconnaissance littéraire. Il lui suffit d’obtenir une femme pour cesser de la désirer, et si celle-ci reste distante et lui livre un amour médiocre, alors seulement il croit éprouver des
sentiments inaltérables qui le conduisent à chaque fois à la déception amoureuse. Sans doute pour ne pas sombrer dans l’écriture poisse du malheur, l’homme déçu se complaît dans la misogynie et
nous livre des réflexions crues et désabusées sur le sentiment amoureux.

« Tu es pour les femmes que tu aimes comme, pour toi, une de ces femmes qui te font débander. »
Impossible pour cet homme de se débarrasser d’une souffrance qui semble s’être faite de plus en plus sincère au fil des ans. La faute à la littérature ? Alors que Cesare Pavese semblait chercher
à la stimuler lors de ses jeunes années, croyant peut-être qu’il s’agissait là d’un matériau littéraire digne d’étude, celle-ci finit par faire partie intégrante de sa vie. Se révélant alors
telle qu’il ne l’avait jamais imaginée, il se rend compte que la souffrance n’a rien de noble. Mais elle s’est installée. Ainsi, même si l’existence de Cesare Pavese est d’une lecture douloureuse
–à condition d’y mettre de l’empathie-, elle ne fait pas l’apologie du sacrifice personnel au profit de convictions ou d’idéologies quelconques. Les pensées de Cesare Pavese seraient presque un
avertissement lancé au lecteur qui croirait encore aux bénéfices réparateurs des souffrances mentale et morale :
« On accepte de souffrir (résignation) et puis l’on s’aperçoit qu’on a souffert et voilà tout. Que la souffrance ne nous a pas servi et que les autres s’en
fichent. Et alors on grince des dents et on devient misanthrope. Voilà. »
Pour autant, Cesare Pavese ne délaisse pas un instant la littérature. Son
Métier de vivre, lui-même, est littérature. Avertissant ses proches de son désir de le voir publier, il
n’est pas rare que l’écrivain s’arrête parfois pour réfléchir aux bénéfices de cette conversation qu’il livre à lui-même. Peut-être désespéré par l’absence de fondations qui constitueraient sa
vie personnelle, il espère trouver du sens et se donner de la consistance à travers le jus qu’il presse de ses idées :
« Tu découvres aujourd’hui que le parcours que refait chacun de ses propres ornières t’a angoissé pendant un certain temps […], et puis […] ce parcours t’est apparu comme le prix joyeux de
l’effort vital et, en fait, depuis lors, tu ne t’es plus plaint, mais […] tu as recherché avec plaisir comment ces ornières se creusent dans l’enfance. […] Tu as conclu […] par la découverte du
mythe-unicité, qui fond ainsi toutes tes anciennes hantises et tes plus vifs intérêts mythico-créateurs.
Il est prouvé que, pour toi, le besoin de construction naît sur cette loi du retour. Bravo. »
Aucune trace en revanche –ou si peu- de ses convictions politiques, qui le rattachèrent d’abord au fascisme dans les années 1935 avant de le voir se tourner vers le communisme dix ans plus tard.
Ces engagements constituaient-ils encore un apparat ? Une manière d’entrer activement dans la vie pour se défendre des tendances qui semblaient au contraire vouloir sans cesse retirer Cesare
Pavese de l’existence sociale ? Où se trouvait l’homme véritable ? S’agissait-il de l’image publique qu’il cherchait à renvoyer, ou de l’image intime qu’il livre à travers son
Métier de
vivre ?
« Ils parlent de gueuletons, de faire la fête, de se voir… Braves amis, amies, gens sains et braves. Toi, tu n’en éprouves même pas l’envie, le regret. Autre
chose presse. »
Sans doute lui-même ne le sut-il jamais. Mais à quoi bon chercher, lorsqu’on finit par comprendre que cette poursuite d’une identité, qui ne peut de toute façon jamais être assurée, conduisit
Cesare Pavese au suicide ?
Qu’on connaisse l’écrivain ou non, qu’on l’apprécie ou pas, son
Métier de vivre est un livre qui trouvera écho en chacun. Parce qu’il traite de thèmes universels, à peine passés
à travers le prisme de la subjectivité d’une existence singulière, il trouvera une résonnance devant laquelle on ne pourra pas rester insensible. Qu’on se reconnaisse dans les angoisses de
l’écrivain, qu’on s’amuse de sa vision du monde désabusée, qu’on se passionne pour ses considérations éclairées sur la littérature et le théâtre, que l’évolution de son identité sur quinze années
mouvementées nous donne l’impression d’être un scientifique se penchant sur le cas d’un rat de laboratoire –et peut-être pour tout ça à la fois- il est impossible de ne pas trouver son intérêt
personnel au
Métier de vivre de Cesare Pavese qui est, peut-être, un peu le métier de vivre de chacun…
 A la mémoire de George Dyer - Francis Bacon
A la mémoire de George Dyer - Francis Bacon
Beaucoup de nostalgie dans toutes les réflexions évoquées par Cesare Pavese...
|
Citation:
|
« Le problème déjà souvent effleuré se rouvre : tu ne t’aperçois pas que tu vis parce que tu cherches le nouveau thème, tu passes, hébété, les jours et les choses. Quand tu auras
recommencé d’écrire, tu penseras seulement à écrire. En somme, quand est-ce que tu vis ? que tu touches le fond ? Tu es toujours distrait par ton travail. Tu arriveras à la mort, sans
t’en apercevoir.
Voilà pourquoi l’enfance et la jeunesse sont source éternelle : alors, tu n’avais pas un travail et tu voyais la vie avec désintéressement. »
|
|
Citation:
|
|
« Pour que la gloire soit agréable, il faudrait que les morts ressuscitent, que les vieux rajeunissent, que reviennent ceux qui sont loin. Nous l’avons rêvée dans un petit cadre, parmi
des visages familiers qui, pour nous, étaient le monde et nous voudrions voir, maintenant que nous avons grandi, le reflet de nos entreprises et de nos paroles dans ce cadre, sur ces
visages. Ils ont disparu, ils sont dispersés, ils sont morts. Ils ne reviendront jamais plus. Et alors nous cherchons autour de nous, désespérés, nous cherchons à reconstituer ce cadre,
ce petit monde qui nous ignorait mais qui nous aimait et devait être étonné par nous. Mais il n’existe plus. »
|
L'amour, selon Cesare Pavese (une pose, encore une fois ? attitude d'un enfant puni qui crache sur le dessert qu'il ne peut pas manger ?)
|
Citation:
|
Celui qui dénonce l’immoralité de l’amour vénal devrait laisser tranquilles toutes les femmes, car, une fois exclus les rares instants où l’on nous offre son corps par amour, même la
femme qui nous a aimés se laisse faire et agit seulement par politesse ou par intérêt, à peu près résignée comme une prostituée.
On peut dire la même chose de l’homme, bien que ce soit peut-être moins fréquent.
Pour sortir de ce drame, il n’y a qu’à condamner aussi l’amour sincère, par le fait que son but est le plaisir. Mais il reste toujours que baiser –qui réclame des caresses, qui réclame
des sourires, qui réclame des complaisances- devient tôt ou tard pour l’un des deux un ennui dans la mesure où l’on n’a plus naturellement envie de caresser, de sourire, de plaire à
ladite personne ; et alors cela devient un mensonge comme l’amour vénal.
|
Je l'ai déjà mis dans mon commentaire mais je tiens encore à le remettre... Ce passage-là est celui qui mérite avant tout de ressortir de cette lecture :
|
Citation:
|
|
« On accepte de souffrir (résignation) et puis l’on s’aperçoit qu’on a souffert et voilà tout. Que la souffrance ne nous a pas servi et que les autres s’en fichent. Et alors on grince des
dents et on devient misanthrope. Voilà. »
|
Ravissantes découvertes...